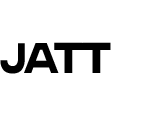Il y a encore peu de temps, lorsqu’on me parlait de documentaire, la première chose qui me venait en tête c’était les lionnes et les gazelles. Les mercredi après-midi à m’ennuyer laborieusement dans le canapé, j’avais probablement 7 ou 8 ans et ma maman corrigeait ses copies à côté de moi.
J’étais sensée faire quelque chose de constructif de mon après-midi, c’est pourquoi je la passais à regarder des animaux de savane cavaler dans les herbes sèches.
Une quinzaine d’années plus tard, je filme pour Jamais assez toujours trop la scène émergente de ma ville, mais mes réalisations n’étaient pas pour moi du documentaire. Je n’ai pas assez de recul, le propos ne me semble pas assez complexe, trop brouillon, pas assez « pro » pour être nommé ainsi.
Il y a un an environ, ma soeur me propose d’aller au cinéma avec sa promotion de sage-femmes pour aller voir un documentaire « long-métrage » et rencontrer sa réalisatrice, Claire Simon. Une grande dame que je n’avais pas encore la chance de connaitre.
Le film-documentaire porte sur la santé des femmes, au coeur du service de gynécologie d’un hôpital parisien. Au fil des scènes, la caméra posée au coeur des salles de consultation ou d’opération nous permet de découvrir les différents sujets qui y sont traités, avec frontalité certes, mais également avec précision et humanité. Je crois que personne ne quitte la salle de cinéma la joue sèche.
C’est ma première « vrai » expérience de documentaire.
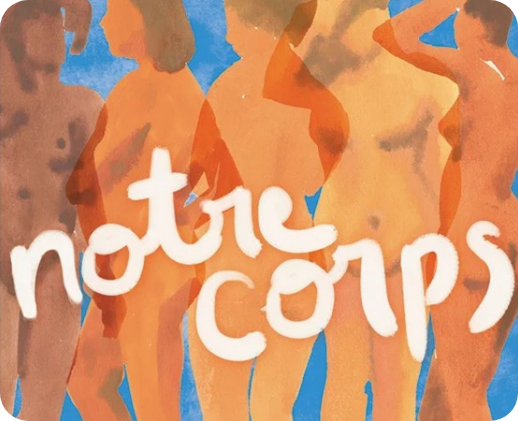
Ensuite il y a (comme une partie de ma génération) le documentaire sur DJ Medhi qui me frappe de plein fouet. Ces images d’archives entrecoupées de témoignages qui m’enferment dans un cycle de mélancolie d’une époque que je n’ai pas connu. Dans mes oreilles résonnent pour plusieurs semaines l’âge d’or de la french touch et du rap des années 2000.
C’est pourquoi lorsque j’entends parler d’Anna Finot et Marie-Soizic Fraboulet, jeunes réalisatrices de documentaires formées à l’INA Sup-ENS Saclay et sélectionnées au festival Traces de vie à Clermont-Ferrand, je saisi l’opportunité qui s’offre à moi. Écrire sur un documentaire, est-ce si différent d’écrire sur une fiction ?
D’un premier abord, il me semble important de définir le terme « documentaire ». Pour cela, rien de mieux que la réponse d’une des deux réalisatrices, Anna : « C’est pas facile de répondre, mais je dirais que c’est un réel qui est mis en scène. La manière dont tu cadres, le regard que tu apporte, c’est c’est ça qui va distinguer un documentaire d’un reportage. Et je pense que c’est ça qui nous a plu dans le documentaire. C’est c’est l’idée d’avoir un regard sur le réel. »
Revenons en au documentaire « Gaëlle n’aime pas l’été« . Ici, il s’agit d’explorer avec poésie et humour les liens entre féminité et cheveux, ce que ce dernier représente et ce que son absence provoque et cela à travers le prisme de Gaëlle.

Gaëlle est une jeune femme de mon âge, la vingtaine. Elle n’a pas de cheveux, ni de cils ni de sourcils à cause de l’alopécie. Le film de Anna et Marie nous entraine au cœur de sa « routine » quotidienne, durant laquelle elle applique des sourcils sur son visages, colle des cils et installe sa perruque. Durant sa préparation, elle revient sur son histoire et sur les liens qu’elle entretien avec sa féminité. Perdre ses cheveux, comment est-ce que c’est ? Comment reconstruire son image après l’annonce de la maladie ? Quelles sont les implications concrètes dans son quotidien ?
Toujours avec beaucoup d’humour, elle nous présente ses différentes perruques, qui lui permettent d’incarner plusieurs femmes, plusieurs personnages. Elle se balade dans la rue en Marylin, va faire quelques courses au supermarché avec les cheveux de Raiponce, ère sur la plage en Marie-Antoinette.
Voici quelques questions que j’ai pu poser aux réalisatrices pour en savoir plus sur le format documentaire et leur démarche.
Julie : Comment vous vous êtes rencontrée et comment en êtes vous venues à faire la formation de l’INA en documentaires ?
Anna : On vraiment parcours un peu similaire avec Marie. Pour ma part, j’ai fait des études en sciences sociales assez pluridisciplinaires, pas très concrètes. Et je faisais beaucoup de stages à côté en rédaction et à la radio. Avec Marie, on s’est rencontrées quand j’étais en alternance dans cette boîte de podcasts qui était Paradiso, maintenant c’est Binge Audio. Et suite à cette alternance, on est rentré en même temps à l’INA et c’était pour faire des études complémentaires à ce qu’on avait déjà fait parce que c’était beaucoup plus technique, plus concrets. C’était en un an et c’était trop génial.
Marie : De base je faisais du son, j’étais plus dans le documentaire sonore et j’ai découvert l’image avec cette formation.
Julie : Si j’ai bien compris, il y a une différence entre reportages et documentaires ?
Anna : Dans le reportage, on va plus, on va plus chercher à être neutre, être objectif, descriptif, factuel. Dans le documentaire, généralement le documentaire de création ou d’auteur, c’est un regard qui est porté sur un sujet. Donc avec un point de vue qui suscite des questions, une vision assumée.
Julie : Comment avez-vous trouvé le sujet de ce documentaire ?
On voulait faire une comédie-documentaire avec comme fil conducteur le corps, la féminité et l’expérience personnelle de ces sujets. On a commencé par interroger des personnes qui perdaient leur cheveux, mais c’étaient souvent des personnes âgées, atteintes de cancer. Donc compliqué d’adopter un ton plus léger. On s’est dit qu’il fallait interroger quelqu’un de plus jeune. Et Marie suivait encore sur Instagram une copine d’enfance qui a de l’alopécie et qui en parle assez librement, Gaëlle. On lui a proposé l’idée et elle a direct été très partante et moteur dans le projet.
Julie : Quelles ont été vos inspirations pour ce documentaire ?
Notre référence commune avec Gaëlle c’est « Les plages d’Agnès », c’est pour ça qu’on a tourné pas mal de plans sur la plage. On a également « Pauline s’arrache », pour le portrait de jeunesse, on y fait référence en ayant le prénom de Gaëlle dans le titre du documentaire, ou encore « Riverboom » pour le documentaire-comédie. On vous recommande vraiment ces trois documentaires !

Julie : Qu’est-ce qui a été le plus compliqué dans la réalisation du documentaire ?
Anna : Je pense que c’était de trouver l’équilibre entre quand filmer, quand ne pas filmer, tu n’as pas envie d’être voyeuriste mais en même temps il y a tellement de choses à capter aussi !
Julie : Qu’est-ce qui vous rend le plus fières dans ce documentaire ?
La musique, l’accompagnement musical des images. On a écouté énormément de son durant le tournage et ça nous accompagné au montage. Et aussi le rythme, on ne s’ennuie pas du tout, c’est très rythmé.

Julie : Est-ce que vous allez continuer à travailler ensemble ? Vous avez des projets futurs ?
On a vraiment kiffé bosser ensemble et je pense qu’on a eu de la chance aussi parce que ça c’est hyper bien passé. Je pense aussi qu’on était complémentaires sur nos façons de travailler. À refaire ! Pour la suite, on réfléchi encore à ce qu’on va faire, on pense continuer à travailler sur les même sujets (les femmes, l’humour) et on cherche à se faire accompagner par des pro car on sera plus à l’école.
Julie : J’ai hâte de voir la suite alors !