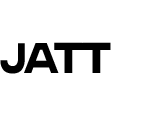Vallayer-Coster et Marguerite Gérard
« En 1789, il n’y avait guère que Mme Guyard, Lebrun, Vallayer-Coster et Mlle Gérard qui eussent une réputation de talent »
(Joachim Lebreton, Rapport sur les Beaux-arts, 1808)
Il est donc temps d’attaquer la seconde moitié de ce XVIIIe, qui fut une période d’affirmation des artistes-femmes, et dont les plus illustres représentantes sont Mme Labille-Guiard, Mme Vigée le Brun, Mme Vallayer-Coster et Mme Gérard.

Vallayer-Coster 1744-1818
La formation
Fille d’un artisan orfèvre travaillant aux gobelins, M. Joseph Vallayer, celle-ci eut probablement sa formation artistique dans ces ateliers des Gobelins. Il est probable qu’elle eut reçu une formation par Mme Madeleine Basseporte, « dessinatrice du jardin royal des plantes », qui a formé à cette même discipline Marie-Thérèse Reboul et les filles de Louis XV avant elle. Elle fréquenta aussi M. Joseph Vernet
L’académie et le modèle de Chardin
Après ces études, elle suit les conseils de son maître Vernet et décide de rentrer à l’Académie royale de peinture et de sculpture. Elle présente entre autres, le 28 juillet 1770, les attributs de la Peinture, de la sculpture et les Attributs de la musique afin d’y être agréée. Il est plus que probable qu’elle ait présenté deux autres tableaux, mais leurs identifications restent délicates.


Ceux-ci par leurs noms mais aussi leurs compositions sont des références directes au-dessus de portes réalisés par Chardin pour le château de Choisy en 1765, et exposés la même année au salon.



Elle y fait une démonstration, à la manière de Sophie Chéron, de la maitrise des attendus de l’académie, ce qui la différencie de Chardin. En effet, elle supprime tous les éléments qui ne renvoient pas à l’activité ou à la symbolique académique. En effet, elle supprime l’aiguière, mais aussi les outils renvoyant à une conception artisanale et mécanique de la profession comme la masse et le levier pour ne garder que les outils du géomètre, du mathématicien, de l’architecte avec le plumier, les livres, le compas, le rapporteur et l’équerre, mais aussi des plans en correction dont témoigne la pointe rouge du porte-mine. Elle place au centre de sa composition un plâtre reproduisant le torse du Belvédère, pour l’enseignement du dessin et du Beau idéal d’après l’antique, même si cette première sculpture est accompagné d’un buste de femme, en terre où sont visibles les traces du travail en cours : empreintes des doigts, ébauchoir, boulettes de terre, linge humide…. Certains y voient une allégorie de la sculpture moderne, d’autres la présence de l’artiste… Les livres étant probablement des traités de géométrie ou même des livres littéraires renvoyant à la peinture d’histoire.

Les Attributs de la musique reprend « la manière heurtée » du maître qualifiant, dans le vocabulaire de l’époque, un travail du pinceau laissant voir de près les coups de pinceau, et qui disparaissent ensuite à bonne distance et se « fondant » les uns avec les autres afin de produire l’illusion de la réalité.
L’Académie accepte de recevoir l’artiste, la première depuis Reboul. Cela, sans être ni fille ni épouse d’académicien, et sans être non plus recommandée officiellement auprès de l’Académie. De fait, l’académie accueille sa seconde membre féminine en 1770. Parmi les membres du jury se trouvaient Vien et Marie-Thérèse Reboul, mais aussi Chardin, Vernet, Roslin, Hubert Robert… Témoignant de la qualité exceptionnelle de son travail, mais aussi de la reconnaissance qu’elle acquit auprès de ses paires, et auprès de la critique.
D’être une femme dans le parcours officiel en cette seconde moitié de siècle.

Ici, comme c’est souvent le cas pour les artistes femmes que nous avons pu voir précédemment, à l’instar des sœurs Bollogne, Sophie Chéron, Marie-Thérèse Reboul… Vallayer-Coster est agréée et reçue le même jour, chose nullement conforme aux statuts de l’académie. Même si, ce fut aussi le cas pour quelques peintres-homme de talents tels que Chardin ou Hubert Robert, la position de Vallayer-Coster est donc ambivalente, entre reconnaissance de son talent et de son nom propre, mais aussi entre discriminations genrées et plafond de verre, puisque les artistes femmes, comme nous l’avons déjà vu n’ont guère de possibilité d’ascension au sein de cette institution. Cela n’empêche pas ces deux tableaux et les autres qu’elle expose au salon de 1771 de recevoir un accueil élogieux, tel que Diderot écrit :
« Il est certain que si tous les récipiendaires se présentaient comme Mademoiselle Vallayer et s’y soutenaient avec autant d’égalité, le Sallon serait autrement meublé ! »
Comme tous les membres de l’Académie, Vallayer-Coster a le droit à un logement aux galeries du Louvre, situé sous la grande galerie du Louvre. Elle jouit d’une très bonne réputation et fut sous les bonnes grâces de la reine Marie-Antoinette : « La reine, qui honore Mlle Vallayer-Coster d’une protection particulière […]» (lettre datée du 23 juin 1779). De fait, elle est la seule membre à bénéficier d’un tel logement en 1773, Mme Reboul vivant avec son mari, et les autres artistes femmes présentes s’étant vu refuser le logement en raison de leur sexe.
Malgré les tourments de la Révolution, celle-ci continue à peindre, en ayant exécuté notamment des peintures pour l’impératrice Joséphine de Beauharnais ou même en ayant probablement offert en 1817 cette nature morte au homard au roi de France Louis XVIII. Elle meurt peu de temps après, en 1818 à soixante-treize ans.

Marguerite Gérard, l’élève intéressante
L’apprentissage chez Fragonard
Autre artiste à la carrière emblématique de cette seconde moitié du siècle est Marguerite Gérard. Né à Grasse en 1761, dans une famille de parfumeurs, celle-ci dut faire face à la mort précoce de sa mère en juillet 1775 et fut adopté peu après par sa sœur Marie-Anne, épouse de Jean Honoré Fragonard, le célèbre peintre de la rocaille française.
Celui-ci, alors en vue pour ses scènes de genre aux aspects érotiques, tel le Verrou (1777-78), se met en tête de former sa belle-famille à la peinture. L’idée de se créer, à la manière des Van Loo, Vernet ou encore Lagrénée, une véritable lignée d’artistes, ne lui était probablement pas indifférente dans ce projet. Après avoir commencé la formation de ses frères et sœurs : Marie-Anne (1745-1823 et qui l’épousa en 1769), Antoine Joseph (1757-1775) et Henri (1755-1840) ; il entreprend vers 1778 la formation de sa belle-sœur, Marguerite Gérard, âgée de 16 ans.

Son apprentissage se fait notamment dans le domaine de la peinture. Ses tableaux portent alors la mention « Mademoiselle Gérard fait sous les yeux de M. Fragonard, son maître ».
Ainsi, Fragonard affiche sa filiation avec la jeune artiste, souhaitant par-là lui faire bénéficier de sa réputation et de sa clientèle. Ici, le cas de Marguerite Gérard est à remettre dans le contexte de ce XVIIIe siècle. En effet, si nous avons vu jusqu’à présent que la carrière académique était un must pour les artistes voulant faire carrière, ce siècle change la donne. Puisqu’on assiste à cette époque au développement, de plus en plus important, d’un marché de l’art et à l’affirmation par les élites culturelles et économiques des notions de goût (individuel) et d’intimité. Ce qui fait que les peintures d’histoires, le grand genre de l’Académie, sont en net recul, la demande privée privilégiant des scènes de la vie quotidienne, galantes, bourgeoises, où elles trouvent un écho à ses valeurs et ses plaisirs.
Il faut aussi, dans ce contexte, pondérer ce que nous avions pu dire précédemment sur la hiérarchie des genres et l’exclusion des femmes de facto du genre le plus noble qui est celui de la peinture d’histoire. En effet, Fragonard en est un exemple éloquent, les peintres au contact de cette nouvelle clientèle privée, se détournent de ce genre complexe : par sa taille, son iconographie savante, la dureté de la critique et les exigences du commanditaire, afin de réaliser des genres plus simples, plus rapides d’exécution et donc plus rentables que sont le portrait, la scène de genre et la nature morte. De plus, ces petits tableaux réalisables en plus grande quantité n’ont pas besoin d’avoir un commanditaire (sauf pour celui du portrait) et peuvent donc être vendus dans les différents salons et ventes organisées de l’époque. La carrière académique n’est donc plus en ce siècle l’alpha et l’oméga de la vie artistique, même si celle-ci jouit d’un prestige et d’une reconnaissance qui restent enviés et enviables.
Tout comme son maître, l’artiste s’inscrit dans cette veine de la peinture de genre, fortement inspirée des peintres de la matière fine du XVIIe siècle hollandais, tels que Gerard Ter Borch, Gérard Dou, Netscher… Avec un rendu des textures lisses et brillantes nécessitant un temps de travail long et minutieux. Elle y décrit l’atmosphère amoureuse jeune femme lisant une lettre de son amant ou mari. Elle rend avec virtuosité les différends rendus des étoffes et textiles, des marqueteries de bois, mais aussi un soin apporté à la lumière et à son influence sur les rendus des matières…. L’atmosphère galante peut refléter la clientèle alors libertine qu’elle a pu hériter de son beau-frère…
Un travail d’émulation et de collaboration artistique
L’un des premiers tableaux qui seraient peints de manière tout à fait autonome par l’artiste serait celui de l’élève intéressante réalisé en 1787, à 26ans. Il s’agit pour l’artiste d’exposer l’entièreté de son talent dans un tableau qui est l’un des plus imposants, par ses dimensions, dans son œuvre. Celui-ci représente une jeune femme vêtue d’une robe de satin blanche au milieu d’un salon à l’allure désordonnée. Elle regarde attentivement un cadre, avec en son sein une gravure ; la fontaine d’amour, réalisée par Fragonard et reprise en gravure par Nicolas-Françoiss Regnault et publiée en 1785. Elle appuie son cadre sur un guéridon orné d’une nappe rouge, avec posé en au-dessus, un groupe statuaire de putti. L’un sert de porte-chapeau. Au pied de ce guéridon, mais aussi au pied de la jeune femme, se trouve une sorte de sphère où l’on aperçoit, à la façon des époux Arnolfini de Van Eyck, ou des Ménines de Velázquez la représentation d’une peintre, probablement Marguerite Gérard, entouré de Fragonard et de son épouse Anne-Marie Gérard. L’œuvre est ainsi un hommage à Fragonard qui l’a formé et propulsé dans le marché de l’art, puisque c’est autour d’une gravure de son maître que la composition de ce tableau gravite. De plus, il est difficile de ne pas entendre dans cette élève un écho avec la mention de « Marguerite Gérard, élève de Fragonard ».

Malgré le fait que la gravure porte la mention « Mme Gérard El[ève] de M. Fragonard pinx. [it] » indiquant qu’elle a réalisé cette œuvre seule, tout en affirmant son enseignement et sa filiation artistique avec Fragonard, le tableau semble avoir été le fruit de la collaboration des deux artistes. Processus qui leur fut commun durant ces années, où elle produisit des scènes de genre à la manière des écoles du nord. Marguerite Gérard et Fragonard réalisant différentes parties d’un même tableau. Une restauration de l’œuvre ayant eu lieu en 2020 montre que Fragonard aurait peint la tête et les deux animaux.
Est-ce que pour autant, cette intervention de Fragonard enlève-t-elle du mérite au travail de Marguerite Gérard ? La réponse est délicate, puisqu’il y a peu de document primaire de la main de l’un ou de l’autre artiste qui relate de ce processus créatif commun. Pour autant, il est probable que cette intervention ne soit pas purement l’intervention du maître sur la toile de l’élève, qui minimiserait le travail de l’élève (masculin ou féminin), mais bel et bien un travail d’émulation et une réelle collaboration entre les deux artistes, comme semble l’indiquer par exemple certains tableaux « peint par M. Fragonard et Mlle Gérard ». Les deux travaillaient aussi souvent côte à côte sur des sujets semblables, mais affirmant chacun une identité propre. Ceci peut nous faire penser à ce que nous avions déjà aperçu avec la probable collaboration entre Marie-Thérèse Reboul et son époux Vien. Même si, dans ce cas, l’une est subordonnée au sein de l’académie au genre mineur et à la reproduction servile, tandis que l’autre peint les parties les plus prestigieuses, fruit de son imagination…
Elle eut un certain succès dans sa carrière, réussissant à être autonome financièrement et à pourvoir aux besoins de sa famille et belle-famille après la mort de Fragonard. Elle réussit comme Mme Vallayer-Coster à traverser les troubles de la fin du siècle avec succès, et mourut en 1837 dans une grande discrétion, n’ayant rien peint depuis 1824.
Bibliographie
FAROULT Guillaume, Marguerite Gérard, « L’Élève intéressante », Paris, Louvre éditions, 2023
BLUMENFELD Carole, Marguerite Gérard: 1761-1837, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, 2019
GLORIEUX Guillaume, l’art du XVIIIe, Rennes, presses universitaires de Rennes, 2021
LACAS Martine, Des femmes peintres du XVe à l’aube du XIXe siècle, Paris, Seuil, 2015
LACAS Martine, Peintres femmes 1780-1830. Naissance d’un combat, cat. d’exp., Paris, musée du Luxembourg, 3 mars au 4 juillet 2021, Paris, édition de la réunion des musées nationaux – Grand Palais, 2021
KAHNG Eik, ROLAND MICHEL Marianne,Anne Vallayer-Coster : peintre à la Cour de Marie-Antoinette : [exposition itinérante, Washington, National Gallery of art, Dallas Museum of art, New-York, The Frick Collection, Musée des beaux-arts de Marseille, 2002-2003], Marseille : Musée des beaux-arts de Marseille ; Paris : Somogy éditions d’art, 2003
Héros et martyrs : Salons de 1769, 1771, 1781, textes établis et présentés par Else Marie Bukdahl, Michel Delon, Didier Kahn, Annette Lorençeau. Pensées détachées sur la peinture, texte établi et présenté par Else Marie Bukdahl, Annette Lorenceau, Gita May, Paris, Hermann, 1995